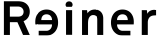Par la rédaction, le 17 Mai 2020 (Temps de lecture : 2 min)
Lorsqu’Andrea Crews présente ses premières collections, l’upcycling en est à ses balbutiements et subit la méconnaissance du public : « Cela reste très compliqué parce que tu as une image de seconde main, qui dans l’imaginaire collectif se doit d’être moins cher, explique Maroussia Rebecq. Alors que finalement le travail de sourcing et de production est beaucoup plus difficile à appréhender. » D’autant plus que pendant de longues années, et jusqu’à très récemment encore, la consommation green n’intéresse pas grand monde et se retrouve vite affiliée à des clichés « babos » et « néo-hippie » facilement tournés en dérision. « Il y a dix ans dans les salons de mode éthique, tu n’avais que des petits vêtements en chanvre ou en laine bouillie dans des gammes de verts ou marron, se souvient la créatrice d’Andrea Crews. C’était ça « être bio » ». Problématique, cette représentation dans l’imaginaire collectif n’encourage pas les jeunes labels ambitieux à revendiquer leur adhésion écologique : « J’ai toujours fait de l’upcycling, et même si on l’a mis en avant, je n’ai jamais voulu être affiliée à une marque éthique ou green, poursuit Maroussia Rebecq. C’était effectivement hyper ringard ».
À Amsterdam, le designer hollandais Ronald van der Kemp, créateur de la griffe éponyme, travaille lui aussi à partir de chutes, deadstocks ou produits vintages pour éviter le gaspillage et la pollution, et partage le même constat : « C’est pour cela que quand j’ai lancé mon label, j’ai laissé parler les habits. Je ne voulais pas être mis dans le « mauvais camp » ».